La loi “Avenir professionnel” du 5 septembre 2018

Adoptée dans un contexte de mutation profonde du marché du travail, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dite “Avenir professionnel”, s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de la formation, de l’emploi et de la politique sociale.
Parmi ses apports majeurs, elle redéfinit en profondeur le dispositif d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), hérité des lois de 1987 et de 2005.
L’ambition du législateur est double : simplifier les procédures pour les employeurs tout en renforçant l’inclusion directe des personnes handicapées dans l’emploi ordinaire. Cette réforme marque un tournant pragmatique et symbolique, en faisant de la responsabilité sociétale des entreprises un levier concret d’égalité des chances et de performance durable.
Une refonte majeure de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
Promulguée le 5 septembre 2018, la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réorganisé en profondeur le système français de la formation, de l’apprentissage et de l’emploi.
Elle visait à moderniser la politique de l’emploi pour l’adapter aux mutations économiques et technologiques, mais aussi à simplifier les obligations légales des entreprises.
Parmi ses volets les plus importants figure la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), un dispositif créé par la loi du 30 juillet 1987 et renforcé en 2005.
L’objectif du législateur en 2018 était clair : renforcer l’emploi direct, rendre le système plus lisible et adapter la contribution à la réalité économique des entreprises.
Objectifs de la réforme de 2018
Le gouvernement a voulu faire évoluer la loi pour :
-
Favoriser l’emploi direct plutôt que les compensations financières ;
-
Simplifier le dispositif administratif pour les entreprises ;
-
Réévaluer régulièrement le taux d’emploi légal ;
-
Encourager les accords et partenariats inclusifs ;
-
Et mieux accompagner les employeurs publics et privés dans leur politique handicap.
L’enjeu était de passer d’une logique de contrainte à une logique d’engagement durable en faveur de l’inclusion.
L’OETH rénovée : les grands principes
Depuis la réforme, la loi de 2018 conserve le principe du quota de 6 % de travailleurs handicapés, mais modifie profondément son application.
Calcul fondé sur l’effectif annuel moyen
L’OETH s’applique désormais à tous les employeurs d’au moins 20 salariés, comme auparavant,
mais le calcul se base sur l’effectif moyen annuel de l’entreprise, et non plus sur un instantané au 1er janvier.
Contribution centralisée à l’URSSAF
La contribution annuelle due par les entreprises qui ne remplissent pas leur obligation d’emploi est désormais recueillie et gérée par l’URSSAF (et la MSA pour le secteur agricole), puis reversée à l’AGEFIPH ou au FIPHFP.
Cela simplifie le circuit administratif, auparavant dispersé.
Obligation d’emploi “réévaluée tous les cinq ans”
La loi prévoit que le taux de 6 % pourra être réexaminé tous les cinq ans par décret, en fonction de l’évolution du marché de l’emploi et du taux d’emploi des personnes handicapées.
Les nouveautés essentielles pour les employeurs
Simplification de la déclaration
Avant 2018, la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) se faisait via un formulaire spécifique.
Depuis la réforme, cette déclaration est intégrée à la DSN (Déclaration Sociale Nominative).
→ Cela permet un suivi automatisé et moins de charge administrative.
Nouveau mode de calcul de la contribution
Le montant de la contribution est désormais calculé :
-
sur la base du nombre de bénéficiaires manquants,
-
multiplié par un montant unitaire modulé selon la taille de l’entreprise,
-
et tenant compte de certains éléments : contrats avec le secteur protégé (ESAT, EA), sous-traitance, stages, alternance, etc.
Prise en compte de la sous-traitance et des partenariats
Les achats et prestations réalisés auprès du secteur protégé et adapté (ESAT, EA, etc.) continuent de réduire la contribution, mais selon un plafond global de déduction révisé.
L’idée est d’encourager le partenariat sans en faire un substitut à l’emploi direct.
Définition unifiée des bénéficiaires
La loi harmonise la définition des bénéficiaires de l’OETH, qu’ils soient du secteur public ou privé :
RQTH, pensionnés, invalides, titulaires de l’AAH, victimes d’accidents du travail, etc.
Cette clarification facilite la reconnaissance et le suivi.
Le rôle de l’AGEFIPH et du FIPHFP
La réforme ne supprime pas ces deux acteurs historiques, mais redéfinit leurs missions :
-
L’AGEFIPH reste le principal financeur des actions d’accompagnement et d’insertion dans le secteur privé.
-
Le FIPHFP conserve la même fonction pour la fonction publique.
La nouveauté : ces organismes reçoivent désormais les fonds collectés via l’URSSAF, assurant une meilleure transparence budgétaire.
Un accent renforcé sur l’emploi direct et la formation
L’esprit de la réforme est clair : le quota ne doit plus être perçu comme une simple contrainte financière, mais comme un outil pour transformer la culture d’entreprise.
Ainsi :
-
Les entreprises sont incitées à recruter, former et maintenir dans l’emploi leurs salariés en situation de handicap.
-
Les dispositifs d’apprentissage et d’alternance sont ouverts et encouragés pour les travailleurs handicapés.
-
Les plans d’actions internes et les accords agréés restent possibles, mais doivent être orientés vers l’emploi direct et la montée en compétences.
L’accompagnement et le suivi
Pour appuyer la mise en œuvre, la loi a prévu :
-
la création d’un référent handicap obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés ;
-
des actions de sensibilisation intégrées à la formation professionnelle ;
-
et une harmonisation du suivi statistique de l’emploi des personnes handicapées.
Les effets attendus et les premiers bilans
La réforme de 2018 visait une simplification administrative, mais aussi un changement culturel.
Les premiers bilans dressés par l’AGEFIPH et le ministère du Travail montrent :
-
une meilleure traçabilité des déclarations via la DSN ;
-
une hausse du taux d’emploi direct dans les grandes entreprises ;
-
mais encore des écarts persistants dans les PME, où la contrainte reste peu comprise.
Cette loi s’inscrit dans une dynamique de long terme, cherchant à faire de l’inclusion un levier de performance et de diversité, et non une simple obligation légale.
Enjeux et portée de la loi Avenir
La loi “Avenir professionnel” a transformé l’OETH en un outil modernisé et pilotable, tout en :
-
renforçant la responsabilisation des employeurs,
-
consolidant la traçabilité financière des contributions,
-
et favorisant un modèle d’inclusion durable.
Elle marque la continuité du principe posé en 1987 et consolidé en 2005 :
Le handicap n’est plus un motif d’exclusion, mais un enjeu collectif de performance et de cohésion.
La loi de 2018 constitue une modernisation majeure du cadre de l’emploi des personnes handicapées en France. En simplifiant les obligations, en centralisant la collecte et en mettant l’accent sur l’emploi direct, elle cherche à replacer la responsabilité sociale des entreprises au cœur de la politique handicap. C’est une réforme de continuité, mais aussi d’efficacité, qui traduit l’ambition d’un marché du travail plus inclusif, plus transparent et plus équitable.
Les autres publications
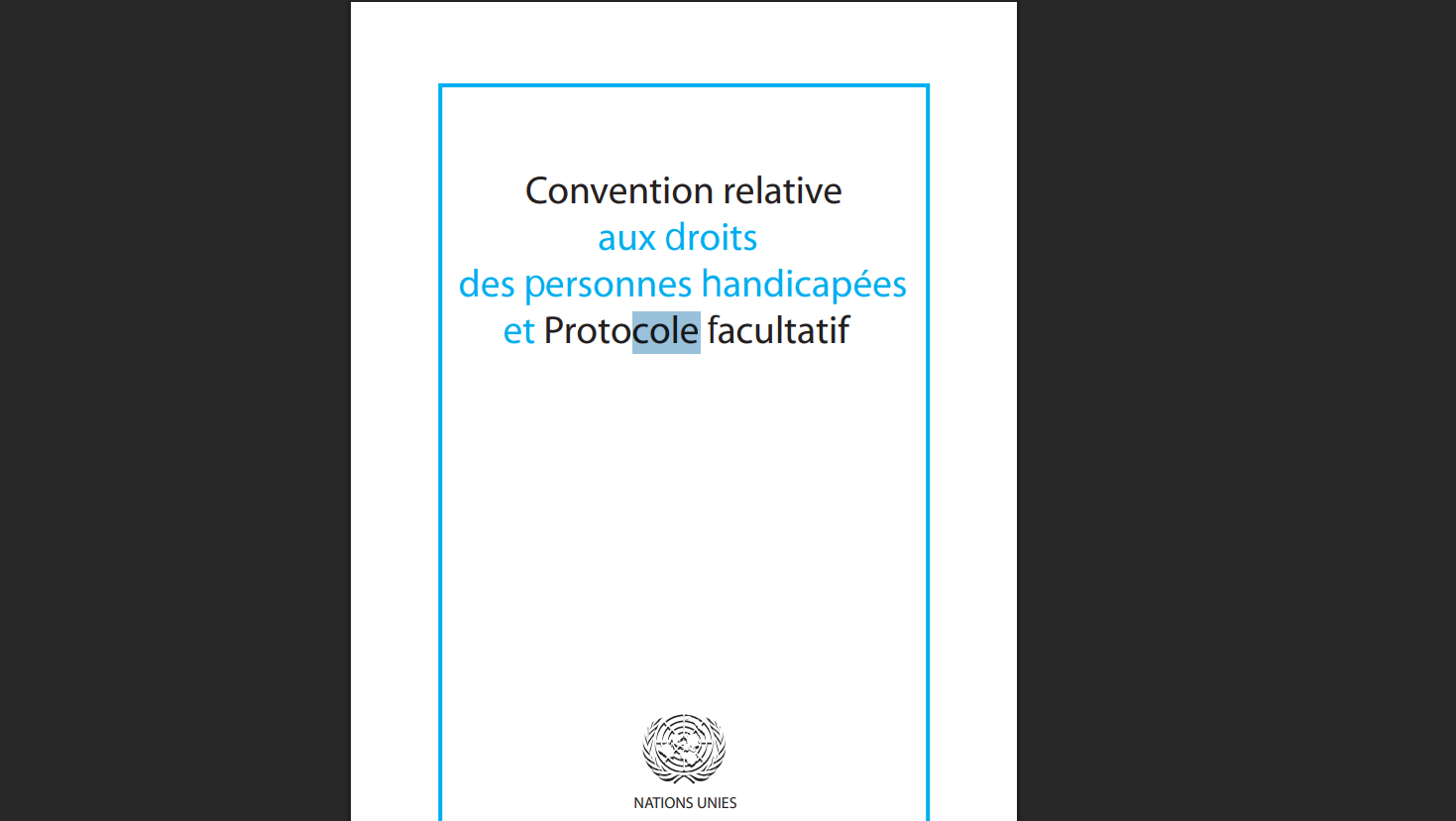
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées : architecture, portée juridique et enjeux d’effectivité
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées constitue un instrument juridique distinct, annexé à la Convention, dont l’objectif est de garantir l’effectivité des droits...
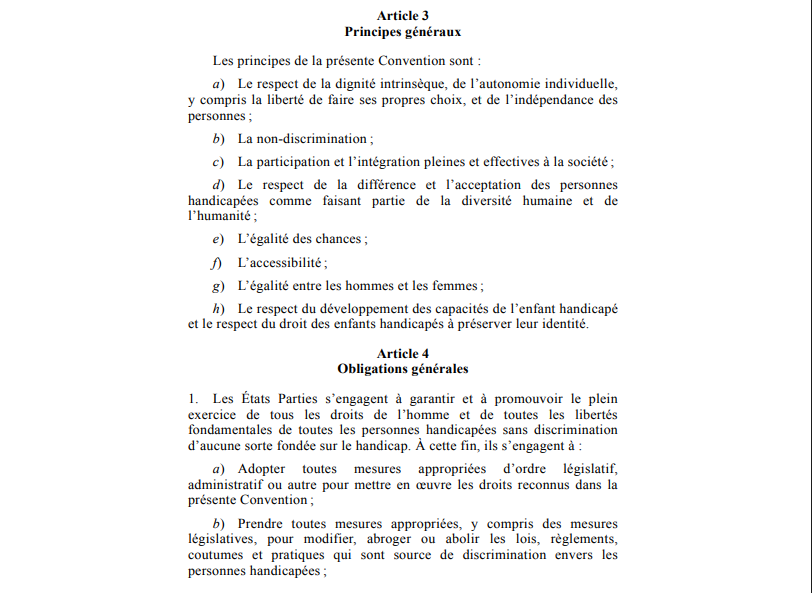
La Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap : un cadre international pour l’égalité
Adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur en 2008, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) constitue une avancée maje...

Réforme de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants : une avancée majeure
Au 1er décembre 2025, la France met en œuvre une réforme structurante : tous les fauteuils roulants seront pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, qu’ils soient manuels, électriques, spécifiques o...