La loi Handicap de 2005 expliquée

Promulguée le 11 février 2005, la loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et a citoyenneneté des personnes handicapées constitue l’un des textes les plus importants de la politique du handicap en France. On vous explique pourquoi.
Contexte et portée générale de la loi Handicap de 2005
Elle affirme le principe d’égalité des droits et des chances, de participation et de citoyenneté des personnes handicapées.
Elle complète et modernise la législation existante, notamment la loi d’orientation du 30 juin 1975, en introduisant des notions nouvelles comme :
- le droit à compensation,
- l’accessibilité universelle
- la participation pleine et entière à la vie sociale.
L’article 1er de la loi établit une définition élargie du handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Cette définition marque une évolution majeure : le handicap n’est plus seulement une déficience individuelle, mais une interaction entre la personne et son environnement.
Les grands principes posés par la loi Handicap
La loi du 11 février 2005 repose sur quatre piliers fondamentaux :
- Le droit à compensation du handicap
- L’accessibilité généralisée
- La scolarisation et l’emploi des personnes handicapées
- La citoyenneté et la participation sociale
Elle engage l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises privées dans une démarche collective d’inclusion.
Le droit à compensation
Le droit à compensation est l’un des apports centraux de la loi.
Il est défini à l’article L.114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) :
« Toute personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. »
Cette compensation peut prendre plusieurs formes : aide humaine, aide technique, aménagement du logement ou du véhicule, aides animalières, aides spécifiques ou exceptionnelles.
Elle est attribuée sous forme de Prestation de compensation du handicap (PCH), versée par le département.
L’accessibilité universelle
La loi de 2005 consacre le principe d’accessibilité pour tous, qui s’étend à l’ensemble des domaines de la vie sociale :
- Bâtiments et établissements recevant du public (ERP)
- Transports publics
- Logement
- Emploi
- Systèmes d’information et de communication
L’article 41 stipule que :
« La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Ce principe impose aux acteurs publics et privés de garantir une accessibilité physique et sensorielle.
Le texte prévoit également des échéances de mise en conformité, et la possibilité d’aménagements spécifiques lorsque la conformité totale n’est pas techniquement possible.
L’éducation et la scolarisation
La loi reconnaît le droit à la scolarisation en milieu ordinaire pour tout enfant handicapé.
L’article 19 précise :
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est inscrit dans l’école ou dans un des établissements le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. »
Des dispositifs d’accompagnement (auxiliaires de vie scolaire, aujourd’hui AESH) sont prévus pour faciliter la présence en classe.
La loi crée également les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), guichets uniques chargés d’accueillir, d’informer et d’orienter les personnes handicapées et leurs familles.
L’emploi des personnes en situation de handicap
La loi de 2005 confirme et renforce le dispositif d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), instauré par la loi de 1987.
L’article L.5212-2 du Code du travail rappelle que :
« Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés. »
Cette obligation peut être remplie :
- par l’embauche directe de travailleurs handicapés,
- par la sous-traitance à des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT),
- ou par le versement d’une contribution à l’AGEFIPH (secteur privé) ou au FIPHFP (secteur public).
La loi renforce également les dispositifs d’accompagnement, de formation et d’adaptation des postes de travail.
La citoyenneté et la participation à la vie sociale
L’un des principes fondateurs de la loi est la citoyenneté pleine et entière des personnes handicapées.
Elle garantit leur droit à participer à la vie politique, culturelle et sociale.
L’article 2 du texte affirme :
« La personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »
Cela comprend notamment :
- l’accessibilité des lieux de vote,
- l’accès à la culture, au sport, aux loisirs,
- la possibilité de bénéficier d’un accompagnement adapté pour les démarches administratives ou judiciaires.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)
Créées par la loi, les MDPH constituent un guichet unique pour l’ensemble des démarches liées au handicap.
Elles assurent :
- L’accueil et l’information du public,
- L’évaluation des besoins,
- L’attribution des droits et prestations,
- L’orientation scolaire, professionnelle et médico-sociale.
Chaque MDPH est placée sous la responsabilité du Conseil départemental et associée à un Comité de coordination regroupant les acteurs publics, associatifs et de santé.
Gouvernance et coordination des politiques publiques
La loi de 2005 met en place un cadre institutionnel visant à coordonner l’action publique :
- Le Comité interministériel du handicap (CIH), placé sous l’autorité du Premier ministre.
- L’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap (ONFRIH).
- Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), organe consultatif chargé de représenter les personnes concernées dans l’élaboration des politiques publiques.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un texte fondateur de la politique française du handicap.
Elle reconnaît pleinement les personnes handicapées comme citoyens à part entière, leur garantissant des droits fondamentaux à la compensation, à l’accessibilité, à l’éducation, à l’emploi et à la participation sociale. La loi est notamment complétée par l’Arrêté du 8 décembre 2014.
Les autres publications
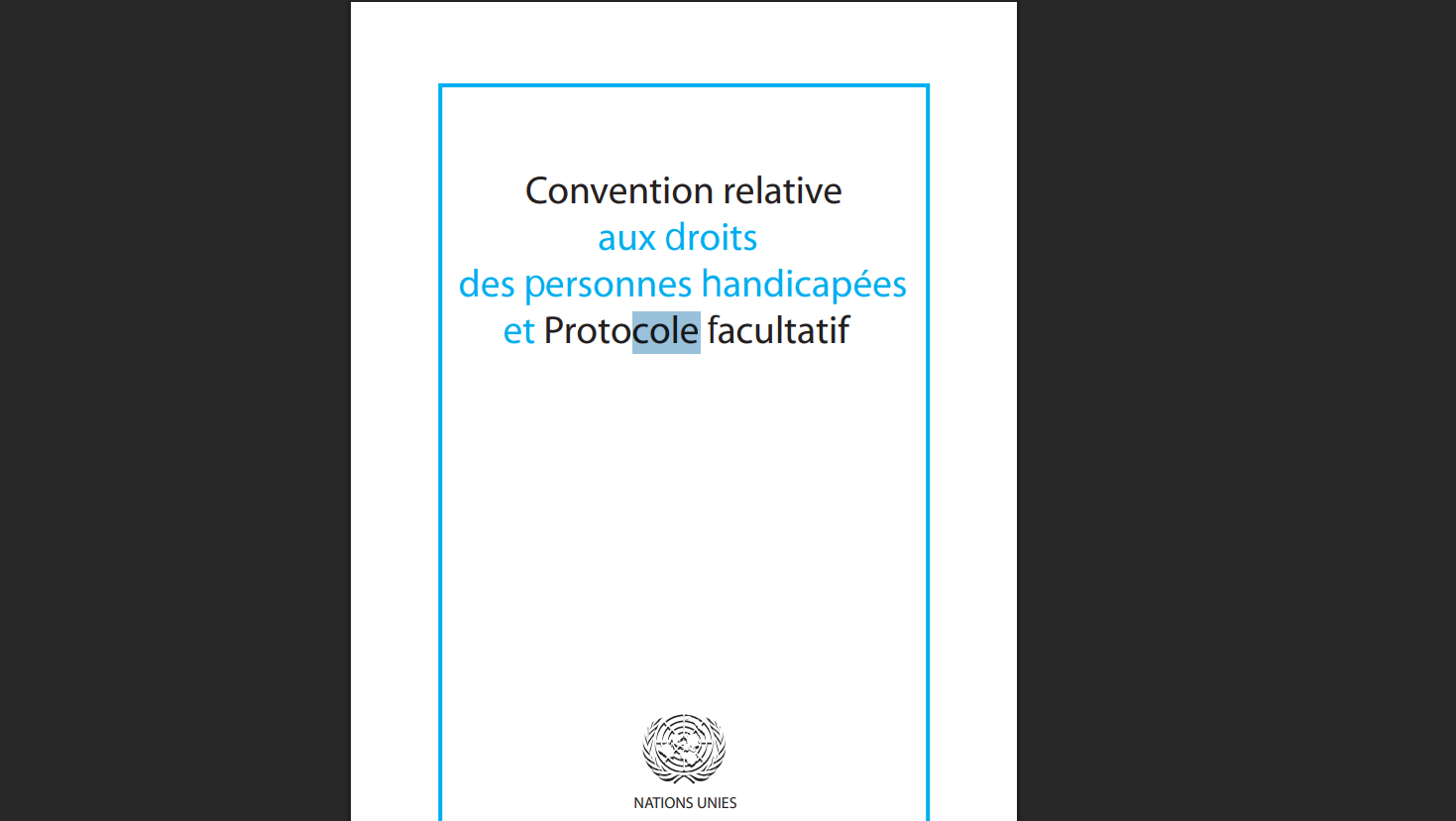
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées : architecture, portée juridique et enjeux d’effectivité
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées constitue un instrument juridique distinct, annexé à la Convention, dont l’objectif est de garantir l’effectivité des droits...
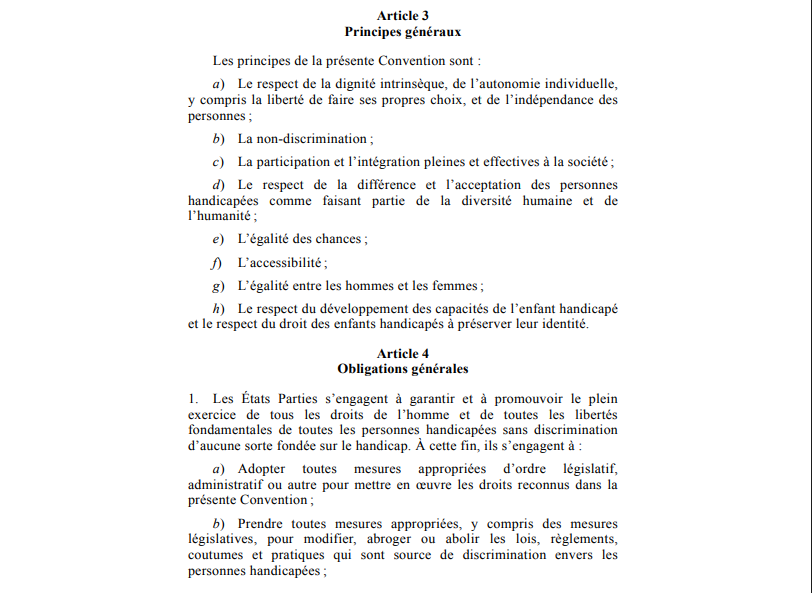
La Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap : un cadre international pour l’égalité
Adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur en 2008, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) constitue une avancée maje...

Réforme de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants : une avancée majeure
Au 1er décembre 2025, la France met en œuvre une réforme structurante : tous les fauteuils roulants seront pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, qu’ils soient manuels, électriques, spécifiques o...